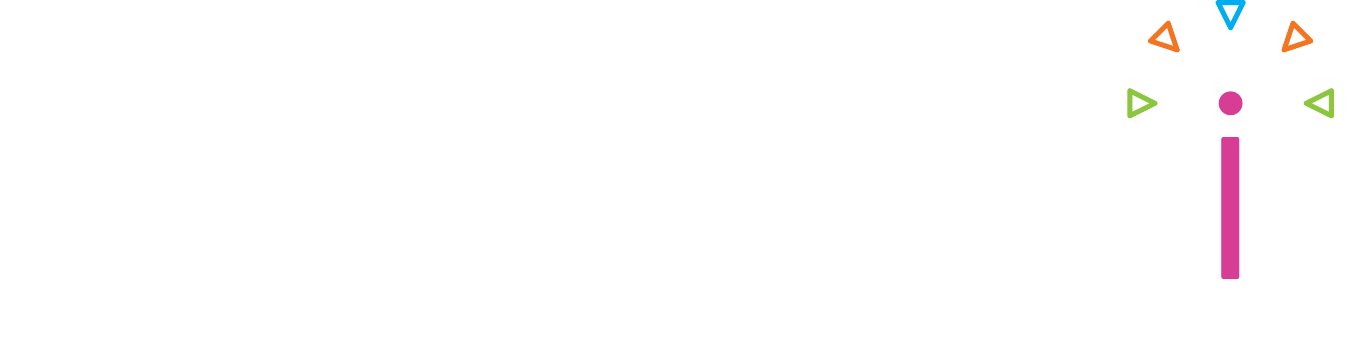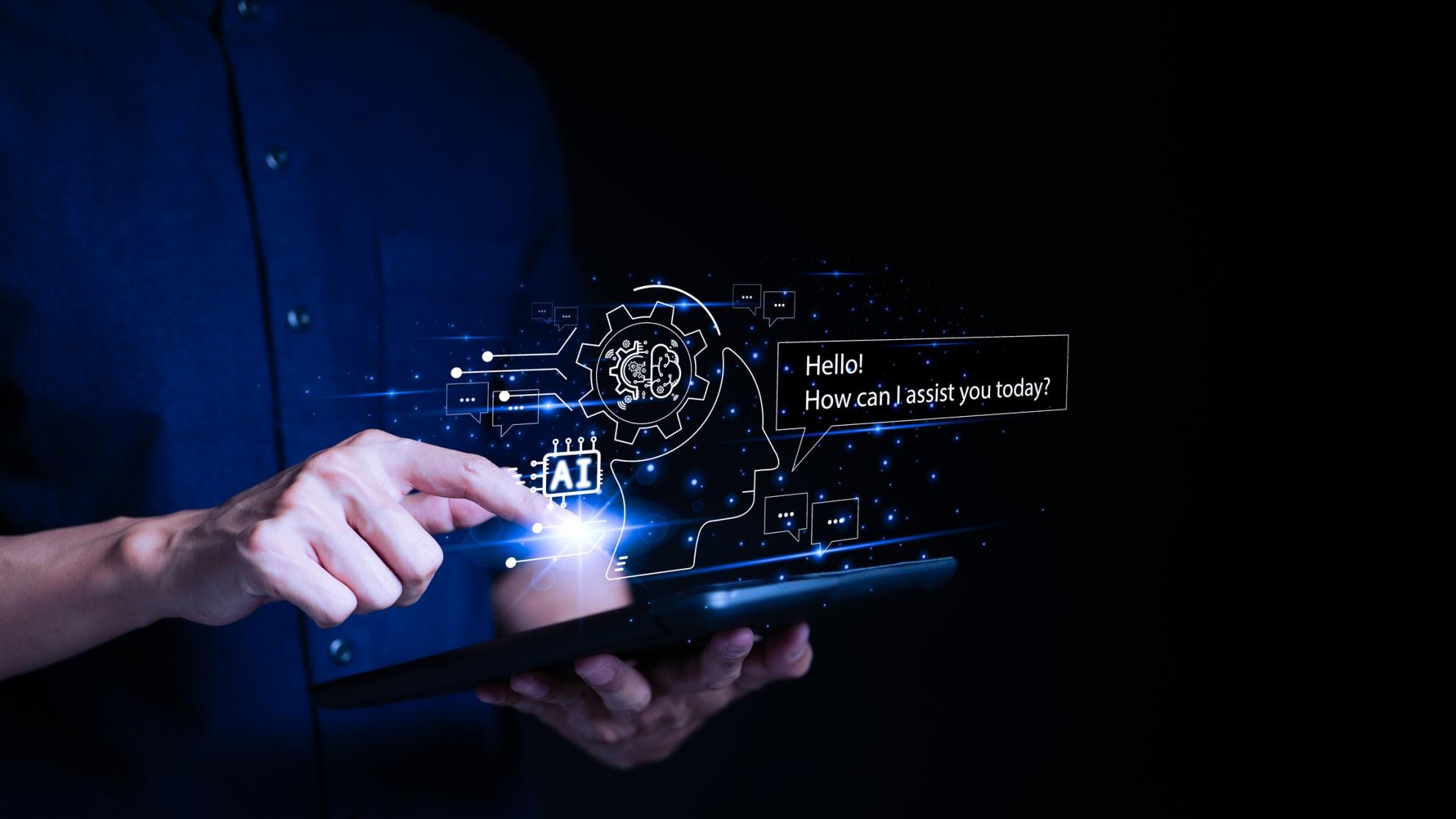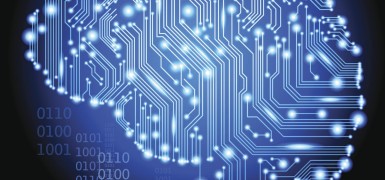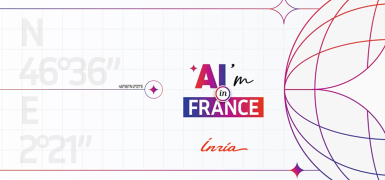Si vous n’aviez pas encore eu l’occasion de tester les capacités de l’IA générative, en voici une démonstration. Le paragraphe précédent n’a pas été rédigé par un être humain mais par ChatGPT, l’agent conversationnel (ou chatbot) de la société OpenAI. Dévoilé en novembre 2022, ce système a fait l’effet d’une révolution auprès du grand public. Deux mois après son lancement, il dénombrait déjà plus de 100 millions d’utilisateurs et utilisatrices. Aujourd’hui, ChatGPT demeure l’IA générative la plus connue et la plus utilisée, avec quelque 1,8 milliard de visites mensuelles sur la plateforme dédiée.
L’Université Paris-Saclay traverse aussi cette révolution de l’IA générative. Mais comment cela s’y illustre-t-il ? Cette question a été abordée lors de la journée organisée le 5 juin dernier sur le plateau de Saclay par la Direction de l'innovation pédagogique (DIP) et la Graduate School Métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur (GS MRES), avec le soutien de l'Institut DATAIA, l’institut d’intelligence artificielle de l’Université Paris-Saclay. « L’objectif était de démystifier l’IA générative et d’offrir un panorama pluridisciplinaire de l’utilisation des outils comme ChatGPT à l’université », explique Serge Pajak, chercheur au laboratoire Réseaux, Innovation Territoires Mondialisation (RITM - Univ. Paris-Saclay) et chargé de mission IA générative à l’université. « ChatGPT est devenu tellement populaire que de nombreuses étudiantes et étudiants l’utilisent déjà. Ceci impose en quelque sorte à la communauté enseignante de se positionner par rapport à cette technologie pour en orienter les bonnes pratiques. » À l’Université Paris-Saclay, des enseignantes et enseignants se sont déjà emparés du sujet, en posant par exemple au chatbot une question de cours et en commentant sa réponse avec les étudiantes et étudiants. « C’est une méthode intéressante car très efficace pour intégrer l’IA dans l’enseignement et la mobiliser de manière critique, en discutant de la qualité de son contenu. »
Cartographier les usages et les compétences en IA générative au sein de l’université, c’est justement la tâche principale du chargé de mission. Avec la DIP et la GS MRES, « nous travaillons aussi à construire un accompagnement à l’utilisation de ces outils. L’idée est notamment de proposer des formations sous forme d’acculturation avec une approche assez pratique, ainsi qu’une sensibilisation sur les mésusages potentiels de cette technologie. » Parmi ces mésusages, on compte par exemple le fait de laisser à ChatGPT le choix de valider, ou non, un projet après l’analyse de son dossier. Or « sa mécanique interne n’est pas du tout adaptée à cela », assure Serge Pajak. Pour comprendre pourquoi, il faut plonger au cœur même de l’IA générative, ou plutôt des multiples systèmes que recouvre ce terme.
Cet article est issu de L'Édition n°25, le journal scientifique de l'Université Paris-Saclay.
L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique.
Pour découvrir d'autres articles et sujets, abonnez-vous au journal L'Édition et recevez les prochains numéros : ici !